Données sur l'eau
L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.
-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"
-
04/01/2024
- www.oieau.fr
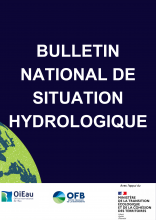
Le bulletin national de situation hydrologique (BSH national) décrit l'état des ressources en eau sur le territoire métropolitain de l’année hydrologique précédente.
L’année hydrologique est définie comme la période de 12 mois débutant après le mois habituel des plus basses eaux. En fonction de la situation météorologique des régions, l'année hydrologique peut débuter à des dates différentes, mais en France métropolitaine, il est considéré qu’elle débute au mois de septembre. Le bilan de situation hydrologique annuel traitera ainsi la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Le bulletin est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent la situation quantitative des ressources en eau selon des grands thèmes : pluviométrie, débits des cours d’eau, niveau des nappes d’eau souterraine, état de remplissage des barrages-réservoirs et du manteau neigeux. Il fournit également une information synthétique sur les arrêtés préfectoraux pris pour limiter les usages de l’eau durant la période d’étiage.
Il est le résultat d’une collaboration de différents producteurs et gestionnaires de données : Météo France, DREAL, SHAPI, BRGM, VNF, des EPTB et l’OFB.
Le bulletin est réalisé sous l’égide du comité de rédaction, composé des différents contributeurs du BSH (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office International de l’Eau (OiEau), en lien avec l’OFB et la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’écologie.
Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Milieu et habitat, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Risque -
04/01/2024
- www.oieau.fr

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH national) décrit l'état des ressources en eau sur le territoire métropolitain de l’année hydrologique précédente. L’année hydrologique est définie comme la période de 12 mois débutant après le mois habituel des plus basses eaux. En fonction de la situation météorologique des régions, l'année hydrologique peut débuter à des dates différentes, mais en France métropolitaine, il est considéré qu’elle débute au mois de septembre. Le bilan de situation hydrologique annuel traitera ainsi la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Le bulletin est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent la situation quantitative des ressources en eau selon des grands thèmes : pluviométrie, débits des cours d’eau, niveau des nappes d’eau souterraine, état de remplissage des barrages- réservoirs et du manteau neigeux. Il fournit également une information synthétique sur les arrêtés préfectoraux pris pour limiter les usages de l’eau durant la période d’étiage.
Il est le résultat d’une collaboration de différents producteurs et gestionnaires de données : Météo France, DREAl, SHAPI, VNF, des EPTB, BRGM et OFB.
Le bulletin est réalisé sous l’égide du comité de rédaction, composé des différents contributeurs du BSH (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office International de l’Eau (OiEau), en lien avec l’OFB et la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’écologie.
Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Milieu et habitat, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Risque -
19/12/2023
- www.oieau.fr

Dans la continuité de la seconde quinzaine d’octobre, les passages pluvieux se sont succédés sans discontinuer. Ils ont été plus nombreux que la normale sur la majeure partie du pays. En revanche, ils ont été moins fréquents que la normale de la moyenne vallée du Rhône au pourtour méditerranéen ainsi que sur le nord-est de la Corse. Les précipitations ont été excédentaires de plus de 30% sur une grande partie du territoire. Les cumuls ont généralement atteint une fois et demie à trois fois la normale du Cotentin aux Hauts-de-France et au Grand Est, de la Franche-Comté aux Hautes-Alpes ainsi que du sud du Poitou-Charentes à l’ouest du Massif central et du piémont pyrénéen jusqu’au Pays basque. Ils ont été proches de la normale de l’ouest des Pyrénées à l’Ariège, sur le sud de la Corse ainsi que par endroits du nord-est de la Bretagne à la Bourgogne. En revanche, les pluies ont été déficitaires de plus de 30% sur l’est de la Haute-Corse et de plus de 50% des Pyrénées-Orientales à l’Ardèche et aux Alpes-Maritimes. Le déficit a généralement dépassé 75% du Roussillon à la Camargue et sur la Côte d’Azur. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de plus de 50%, classant novembre 2023 au 5e rang des mois de novembre les plus arrosés depuis 1959.
Les précipitations globalement excédentaires ont contribué à une très nette humidification des sols superficiels sur tout le pays à l’exception de l’est de la Corse et du pourtour méditerranéen. Les sols sont devenus proches de la saturation sur la majeure partie du pays. L’indice d’humidité des sols moyen sur la France, en dessous du 1er décile mi-octobre, est remonté durant la seconde quinzaine entre le 8e et le 9e décile où il s’est maintenu durant tout le mois de novembre, situation habituellement observée en janvier et février. L’indice d’humidité est resté entre le 8e et le 9e décile pour la Bourgogne-Franche-Comté et a dépassé le 9e décile pour la Normandie, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Il a atteint des valeurs records pour la Nouvelle-Aquitaine du 4 au 16 novembre. Des crues et des inondations ont été observées des Vosges au département du Rhône et aux Pays de Savoie, en Charente-Maritime et en Vendée et surtout sur le Nord-Pas-de-Calais où elles ont été exceptionnellement durables.
En revanche, les sols sont restés secs à très secs autour du golfe du Lion ainsi que sur l’est de la Haute-Corse. L’indice d’humidité, proche du niveau record bas mi-octobre sur les Pyrénées-Orientales, est remonté entre le 1er et le 2e décile en novembre, situation comparable à celle observée normalement début octobre. Entre la médiane et le 1erdécile sur la Haute-Corse durant la première quinzaine, l’indice d’humidité des sols s’est ensuite maintenu en dessous du 1er décile.
Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Prélèvement, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource -
22/11/2023
- www.oieau.fr

Après un début octobre quasi estival avec un temps remarquablement chaud et sec jusqu’au 13, un défilé de perturbations très actives a balayé la majeure partie de la France durant la seconde quinzaine et le mois s’est achevé dans une ambiance automnale. Avec une température moyenne de 16.4 °C, soit 2.7 °C au-dessus de la normale, octobre 2023 s’est classé au deuxième rang des mois d’octobre les plus chauds enregistrés depuis le début du XXe siècle, derrière octobre 2022 (+3.5 °C). Des épisodes méditerranéens ont concerné principalement les Cévennes du 18 au 19 puis l’est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 19 au 20. Des remontées pluvio-orageuses intenses ont ensuite circulé des Cévennes au Jura le 23. En marge des passages perturbés, le pourtour du golfe du Lion et l’est de la Corse ont été en revanche très peu arrosés.
Les passages pluvieux, généralement plus nombreux que la normale sur un très large quart nord-ouest avec plus de douze jours de pluie, ont été en revanche moins fréquents des Pyrénées à l’Auvergne ainsi qu’autour du golfe du Lion et sur l’est de la Corse. Les précipitations ont été excédentaires de plus de 25 % sur une grande partie de l’Hexagone. Les cumuls ont souvent atteint une fois et demie à deux fois la normale de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire au Grand Est, au sud des Alpes et aux Cévennes ainsi que sur l’extrême nord et ont dépassé deux fois la normale des Landes au Cantal et au Poitou-Charentes. En revanche, les pluies ont été déficitaires des Pyrénées au sud de l’Aveyron, autour du golfe du Lion, sur la Côte d’Azur, l’est et le sud de la Corse ainsi que plus localement sur le centre et le sud de l’Auvergne. Le déficit a dépassé 75 % du Roussillon au littoral languedocien et sur la plaine orientale de la Haute-Corse. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de 40 %. Octobre 2023 se classe parmi les trois mois d’octobre les plus arrosés depuis 1959 sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine.
La combinaison du déficit pluviométrique et des températures remarquablement élevées pour la saison a provoqué un maintien de l’humidité des sols à un niveau particulièrement bas pour la saison durant la première quinzaine d’octobre puis les sols se sont nettement humidifiés suite aux pluies abondantes du 18 au 31 sur une grande partie de l’Hexagone. En fin de mois, l’indice d’humidité des sols superficiels atteint des valeurs proches des records hauts sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. En revanche, les sols restent très secs autour du golfe du Lion ainsi
que sur l’est de la Corse et l’indice d’humidité atteint un niveau record bas en fin de mois sur les Pyrénées-Orientales, niveau inférieur à une situation normalement rencontrée en milieu d’été.En octobre, les niveaux des nappes sont en phase de transition. Les précipitations importantes à partir de mi-octobre et la mise en dormance de la végétation permettent d’initier une recharge des nappes : 41% des niveaux sont en hausse. Les tendances sont cependant contrastées selon la pluviométrie et la réactivité de la nappe.
Les pluies infiltrées sont insuffisantes pour engendrer une amélioration notable de l’état des nappes. La situation reste proche de celle de septembre : 65% des niveaux sont sous les normales mensuelles en octobre (66% en septembre). L’état des nappes demeure contrasté. Les niveaux sont sous les normales mensuelles sur une grande partie du pays, notamment sur le pourtour méditerranéen, le couloir Rhône-Saône et le sud de l’Alsace.
Concernant les cours d’eau, globalement sur l’ensemble du territoire, les débits des cours d’eau se sont améliorés par rapport au mois Précédent, les débits de base restent inférieurs à la médiane.
Au 13 novembre, 13 départements ont mis en oeuvre des mesures de crise et 19 départements sont concernés par des restrictions des usages de
l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison en 2022 sur cette même période, 49 départements avaient mis en oeuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau et 4 départements étaient concernés en 2021, 5 départements en 2020 et 18 départements en 2019.Alsace.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie -
08/11/2023
- bretagne-environnement.fr

La Direction interrégionale de la mer (DIRM NAMO) est un service déconcentré qui conduit les politiques de l’État en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources et de régulation des activités.
La synthèse socio-économique proposée par la DIRM NAMO relate, en faits et chiffres, les activités maritimes en 2022, avec notamment un zoom sur les données de la Bretagne, et ses 4 départements.
Avec plus de 6 364 kilomètres de linéaire côtier, l’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest (NAMO) est intrinsèquement maritime. Son littoral est très diversifié, entre espaces naturels (falaises, plages et cordons dunaires, marais maritimes) et espaces urbanisés, avec des écosystèmes complexes et une forte disparité de ressources. La façade fait face à de forts enjeux environnementaux.
De nombreux secteurs sont présentés dans cette synthèse qui se veut essentiellement descriptive. Son ambition est de porter un éclairage complet sur les activités économiques et anthropiques à l’échelle de la façade Nord Atlantique-Manche Ouest. Les racines profondes des mutations auxquelles les secteurs d’activités maritimes sont confrontés relèvent en effet d’un champ plus vaste que la façade et leur analyse est portée par le secrétariat d’État chargé de la Mer.
Pour en savoir plus et accéder à la synthèse : https://bretagne-environnement.fr/synthse-socio-conomique-facade-maritime-nord-atlantique-manche-ouest-2023-documentationMots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Politique publique, Usage -
08/11/2023
- www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Afin de mieux connaître et de protéger les ressources en eaux souterraines, des dispositifs de suivi automatisé ont été mis en place en Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs décennies, notamment sur les territoires du Poitou-Charentes* et du Limousin, en Gironde, dans les Landes, etc.
Les données issues de ces réseaux de suivi alimentent les outils de gestion quantitative, et permettent de mieux appréhender le comportement des nappes d’eau souterraine et leur évolution dans le temps.
L’Agence régionale de la biodiversité met ainsi à disposition les données piézométriques d’environ 170 stations jugées représentatives de la situation des nappes superficielles. Cette sélection se base sur les piézomètres des réseaux d’observation existants (stations « police de l’eau », réseaux sécheresse départementaux, bulletins de situation hydrologique sur différents territoires, etc.). Cette liste non-exhaustive pourra être complétée ponctuellement.
Pour en savoir plus : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-fiches-de-suivi-du-niveau-des-nappes-deau-souterraine-sont-en-ligne/
Pour accéder à la liste des stations : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau souterraine -
08/11/2023
- www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Les prélèvements désignent la quantité d’eau soustraite au milieu naturel à un instant donné, tandis que la consommation correspond à la différence entre la quantité prélevée et la quantité non restituée dans le milieu, réellement consommée, absorbée. Elle est variable selon les usages.
Cet article revient sur les prélèvements d’eau douce pour l’année 2021 en Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, les prélèvements s’élèvent à environ 1,2 milliards de m3 en Nouvelle-Aquitaine pour 2021 tous usages confondus, ce qui représente le plus faible total depuis 2008, avec une baisse de -13% par rapport à 2020.
Ils se font en majorité dans les eaux souterraines (à hauteur d’environ 60%), notamment pour la production d’eau potable (ressources moins vulnérables) et les besoins agricoles, tandis que les eaux superficielles sont davantage sollicitées par l’usage industriel et la production d’énergie.
Découvrez ensuite le détail de la répartition de ces prélèvements :
En 2021, les prélèvements se répartissent par secteur de la manière suivante (hors production d’énergie du Blayais) :43% pour la production d’eau potable, 40% pour l’usage agricole, 11% pour l’usage industriel et 6% pour la production d’énergie.
Pour en savoir plus : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/prelevements-en-eau-les-derniers-chiffres-2021-sont-sortis/Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Cours d’eau, Prélèvement, Usage -
08/11/2023
- www.oieau.fr

Septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud de la période 1900-2023 et la pluviométrie a été déficitaire de 20% en moyenne sur la France, conduisant à un net assèchement des sols. La vidange se poursuit et 70% des niveaux des nappes sont en baisse. Les conditions anticycloniques ont dominé, entrecoupées de quelques épisodes pluvio-orageux intenses. Le temps est resté chaud et sec la majeure partie du mois, avec un épisode de forte chaleur inédit du 3 au 11. Avec une température moyenne de 21.1 °C, soit 3.6 °C au-dessus de la normale, septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud que la France ait connu depuis le début du XXe siècle. Des pluies diluviennes se sont abattues du Haut-Languedoc aux Cévennes du 15 au 17 puis de l’Ardèche à la Drôme et à l’Isère le 18 lors du premier épisode méditerranéen de l’automne. Le déficit pluviométrique combiné aux températures très élevées pour la saison a provoqué l’assèchement des sols superficiels sur la quasi-totalité du pays. L’état des nappes est contrasté. Il demeure sous les normales mensuelles sur une grande partie du pays, notamment sur le pourtour méditerranéen, le couloir Rhône-Saône et le sud de l’Alsace. Globalement sur l’ensemble du territoire, les débits des cours d’eau se sont détériorés par rapport au mois précédent et sont faibles par rapport à la normale.
Mots-clés:Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie, données et systèmes d'information -
11/10/2023
- www.zones-humides.org

Le centre de ressources zones humides présente l’atlas cartographique des sites humides emblématiques 2010-2020.
Cet atlas cartographique décrit les principales caractéristiques des sites humides emblématiques étudiés lors de la dernière campagne d’évaluation nationale qui couvre la période 2010-2020 et porte sur 189 sites, dont 28 en outre-mer.
L’atlas recense, par grandes catégories de bassin (vallées alluviales, littoral atlantique, Manche et mer du Nord, littoral méditerranéen, outre-mer, plaines intérieures et massif à tourbières) les dispositifs de protection et de gestion qui les concernent et l’occupation de leur territoire. L’évaluation nationale des sites humides emblématiques de France conduite tous les dix ans dans le cadre du Plan national d’actions en faveur des milieux humides vise à dresser l’état de santé des zones humides de France et leur évolution.
Six grandes familles de sites, représentatives de la diversité des écosystèmes humides français et de leur degré de résilience face aux diverses menaces ont été constituées. Les périmètres de ces sites sont disponibles sur le module de cartographie dynamique.
Pour en savoir plus : https://www.zones-humides.org/atlas-cartographique-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020
Voir l’ensemble des atlas : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/atlas-cartographique-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020
Mots-clés:Donnée et système d'information, Zone humide -
25/09/2023
- www.oieau.fr

Des passages perturbés actifs se sont succédés sur une grande partie du territoire du 1er au 5 août dans une ambiance très fraîche pour la saison. Après ce début de mois quasi automnal, la France a connu une vague de chaleur tardive du 17 au 24. Cet épisode caniculaire a été particulièrement long et intense de l’Occitanie à Auvergne-Rhône-Alpes et à la région PACA. Avec une durée de 15 jours du 11 au 25 du Sud-Ouest au Centre-Est, il a été comparable à la canicule historique d’août 2003, avec un pic d’intensité inédit sur ces régions. Le mois s’est achevé par un refroidissement brutal qui s’est accompagné de chutes de neige sur le relief des Alpes et des Pyrénées et par le retour d’orages localement violents sur le nord et l’est de l’Hexagone ainsi que sur l’ouest de la Corse et des Pyrénées.
Les passages pluvieux ont été rares sur l’Occitanie, la région PACA, la vallée du Rhône et la Corse mais plus fréquents qu’à l’ordinaire près de la Manche et sur le quart nord-est. Les précipitations ont été excédentaires de la Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est, sur l’ouest des Pyrénées, des Alpes centrales aux Alpes-Maritimes et sur une grande partie de la Corse. Les cumuls ont souvent atteint une fois et demie à deux fois et demie la normale, voire plus de trois fois la normale par endroits sur l’ouest de la Corse. Les pluies ont été plus hétérogènes de la Bretagne au Centre-Val de Loire, en Bourgogne, des Landes au Limousin, sur la moitié est des Pyrénées, la Provence et l’est de l’île de Beauté. En revanche, elles ont été généralement déficitaires du nord de la Gironde et du Poitou-Charentes au Berry et au Nivernais, de l’est des Landes à l’Auvergne, à la Franche-Comté et au nord des Alpes ainsi que du Roussillon aux Cévennes et à la basse vallée du Rhône. Le déficit, souvent compris entre 20 et 70 %, a dépassé 80 % par endroits sur le Languedoc. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été conforme à la normale.
Les sols superficiels se sont humidifiés près de la Manche et des frontières du Nord, sur les Vosges, les Alpes du Nord et l’ouest des Pyrénées mais se sont asséchés de l’est de la Bretagne au nord de l’Aquitaine jusqu’au nord-ouest de Rhône-Alpes et au sud de la Bourgogne ainsi que sur le pourtour du golfe du Lion. En moyenne sur la France, ils sont conformes à la saison.Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Eau souterraine, Sécheresse -
04/09/2023
- www.oieau.fr

Après un mois de juin très chaud sur l’ensemble de la France et très ensoleillé sur la moitié nord, des perturbations ont circulé sur la façade atlantique et le nord du pays tandis que des conditions anticycloniques persistantes se sont installées sur le quart sud-est avec un dôme de chaleur sur le bassin méditerranéen. Hormis un épisode chaud quasi généralisé sur le pays du 8 au 11 juillet, le temps a été souvent frais pour la saison et nuageux sur le nord et l’ouest de l’Hexagone avec des pluies fréquentes et abondantes au nord de la Loire. En revanche, des conditions très chaudes et sèches se sont maintenues sur le Sud-Est la quasi-totalité du mois. Des orages accompagnés de pluies intenses, de chutes de grêle et de fortes rafales de vent se sont produits principalement sur le Sud-Ouest et le Centre-Est. Ils ont été particulièrement violents le 11 du nord d’Auvergne-Rhône-Alpes aux frontières du Nord-Est et le 12 des Cévennes ardéchoises aux Alpes centrales avec des grêlons dépassant parfois 5 cm.
Les précipitations ont été très contrastées entre le Nord et le Sud. Elles ont été excédentaires de la Bretagne aux Hauts-de-France et au Grand Est. Les cumuls ont souvent atteint une fois et demie à deux fois la normale sur le Nord-Ouest, près de la frontière belge et plus localement en Lorraine, voire plus de deux fois la normale par endroits du Morbihan au Cotentin, sur les côtes normandes et en Île-de-France. Sur le reste du pays, les passages pluvieux ont été rares. Les cumuls, globalement déficitaires de plus de 20 %, ont toutefois été très localement excédentaires suite à des épisodes pluvio-orageux. Le déficit a été souvent supérieur à 50 % sur le quart sud-est. Les pluies ont été quasi absentes sur les régions méditerranéennes avec généralement moins de 5 mm du Gard aux Alpes-Maritimes ainsi qu’en Corse et le déficit a dépassé 90 % sur l’île de Beauté et l’est de la région PACA. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été proche de la normale.
Les sols superficiels se sont humidifiés de la Bretagne aux Hauts-de-France et à la Lorraine mais se sont asséchés sur le reste du pays, notamment du sud des Pays de la Loire au sud de la Bourgogne et au nord d’Auvergne-Rhône-Alpes et sur les régions méditerranéennes. En moyenne sur la France, ils sont conformes à la saison.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource -
22/08/2023
- recherche.data.gouv.fr

Les données du satellite Sentinel-2 (ESA) disponibles en libre accès tous les 5 jours depuis mi-2015 pour l’ensemble de la surface terrestre permettent de cartographier la vitesse d’écoulement des glaciers et de documenter leur évolution dans le temps, un indicateur primordial de leur « état de santé ».
Combinant une haute résolution spatiale (10 m) et une période de revisite de 5 jours, les données optiques du satellite Sentinel-2 (ESA, Copernicus) ont un fort potentiel pour documenter les changements à la surface de la Terre.
Une méthode scientifique est mise en œuvre afin de produire des cartes de vitesse d'écoulement annuelle de surface des glaciers à l'échelle des Alpes européennes sur la période 2015-2021 et à 50 m de résolution.
Ces informations documentent l’état des glaciers de montagne dans le contexte de changement climatique.
Pour en savoir plus : https://recherche.data.gouv.fr/fr/jeu-de-donnee/cartographie-des-vitesses-decoulement-des-glaciers-alpins-a-partir-dobservations-par-satellite
Pour accéder au jeu de données : https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.57745/XHQ7TL
Mots-clés:Changement climatique, Pluie et neige, Donnée et système d'information, Pression -
10/08/2023
- www.copernicus.eu

Les températures record qui ont frappé l'Europe en juillet contribuent à l'augmentation de la température de surface de la mer Méditerranée.
Cette visualisation, basée sur les modèles du Copernicus Marine Service, montre l'anomalie de la température de surface de la mer (SST) pour le 24 juillet 2023. Les données montrent une anomalie allant jusqu'à +5,5°C le long des côtes de l'Italie, de la Grèce et de l'Afrique du Nord.
Le Copernicus Marine Service fournit non seulement des données et des services ouverts sur les paramètres physiques des océans, mais aussi des informations précieuses sur les écosystèmes marins, qui sont essentielles pour surveiller la santé de l'environnement marin.
Pour accéder à l’image haute définition : https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/record-temperatures-mediterranean-sea-july
Mots-clés:Changement climatique, Donnée et système d'information, Littoral, Mer et océan, Qualité de la ressource -
10/08/2023
- www.gesteau.fr

L’irrigation est un usage très important en termes de prélèvements sur la Durance.
Pour accompagner les débats de la CLE du SAGE Durance, le SMAVD a initié une démarche innovante de modélisation bassin versant. Cet outil d’aide à la décision, baptisé C3PO (Connaissance du Changement Climatique : Prospective et Observation), permet de croiser la ressource disponible avec les besoins (actuels et futurs) des différents usages de l’eau ; d’appréhender les interactions (flux) entre l’irrigation, la nappe et la rivière ; d’interroger les effets possibles de l’évolution de l’hydrologie sur la disponibilité de l’eau mais aussi ceux d’une évolution des pratiques et des usages.
Dans le cadre du projet Life Eau&Climat, le SMAVD a mené une étude sur plusieurs territoires pilotes du bassin versant de la Durance pour obtenir une cartographie des surfaces irriguées grâce à la télédétection.
Les cartographies ont ensuite été réalisées à l’échelle du bassin de la Durance, montrant la pertinence des méthodes pour un suivi à grande échelle.
Les résultats constituent un jeu de donnée de référence sur les cultures et l’irrigation dans le cadre du SAGE Durance. Ils alimentent l’outil de modélisation intégré ressource-usages C3PO pour affiner l’estimation des besoins en irrigation.
Un rapport d’études décrit le déroulement de ce projet et ses résultats.
Pour accéder à la cartothèque : https://cartotheque.smavd.org/index.php/view/map?repository=irrigation&project=Teledetection
Pour accéder au rapport final : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/C3-SMAVD_Teledec%26Irrigation_RAPPORT%20FINAL_vdef.pdfPour en savoir plus : https://www.gesteau.fr/document/cartographie-des-surfaces-irriguees-en-durance-par-teledetection
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Cours d’eau, Politique publique -
10/08/2023
- www.eau-seine-normandie.fr

Destinée à tous les publics, les objectifs de cette application sont de permettre de mieux connaître la qualité écologique des rivières de Seine-Normandie et de se baigner sans risque sanitaire.
Les agences de l’eau viennent d’actualiser leurs données sur la qualité de l’eau des rivières de France disponibles sur l’application gratuite « qualité rivière » consultable sur smartphone, tablette et sur PC. Ces données sont issues d’un dispositif de surveillance des milieux aquatiques et rendent compte de l’état écologique des rivières et de la présence des poissons.
Ainsi l’état des cours d’eau, poissons et baignades du bassin Seine-Normandie sont consultables sur une carte interactive.
Un picto « poissons » signale que le chabot nage dans l’Andelle par exemple ou la Lamproie de Planer et la truite dans le Cailly et un picto « baigneur » est affiché sur chaque site de baignade autorisé avec des données sur la qualité sanitaire des eaux qui sont issues du ministère de la Santé et disponibles en temps réel sur l’application.
11 indicateurs témoins de la santé d’une rivière accompagnent ces informations sur les poissons, les invertébrés, les micro-algues, les polluants chimiques, l’acidité, la température…
Pour en savoir plus : https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/CP_quali_rivi%C3%A8res_bassinSN.pdf
Et https://www.eau-seine-normandie.fr/index.php/node/4452
Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Cours d’eau, Qualité de la ressource -
10/08/2023
- www.gesteau.fr

Afin de faciliter la compréhension et l’intégration des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a publié fin juin la plateforme TURB’Eau (Territoires, URBanisme et Eau).
Elle est à destination des services techniques de collectivités, des services d’urbanisme, de bureaux d’étude, agences d’urbanisme, conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE), ou encore des animateurs de SAGE.
La navigation dans la plateforme est accompagnée à l’aide d’une part de parcours guidés, qui proposent des fiches (objectifs, enjeux, références juridiques, références au SDAGE, PGRI…, documents complémentaires…).
La rubrique « Ressources » fournit d’autre part des informations transversales aux thématiques avec les relations entre les documents de l’eau et l’urbanisme, les acteurs à associer, des conseils pour la rédaction de cahier des charges d’élaboration des documents d’urbanisme, un glossaire.
Pour accéder à la plateforme : https://www.turbeau.eau-seine-normandie.fr/
Pour en savoir plus : https://www.eau-seine-normandie.fr/node/4432
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Aménagement, Politique publique, Urbanisation -
09/08/2023
- www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Le retour d’expérience de l’étiage 2022 sur le bassin Adour-Garonne a identifié divers enjeux et pistes d’amélioration, dont un besoin significatif en matière d’amélioration des connaissances. En effet, si des outils existent déjà sur certains secteurs voire sous-bassins, le développement et ou le renforcement d’outils d’aide à la décision à l’échelle des sous-bassins versants est pertinent. De plus, la connaissance systématique et dynamique de l’état des réserves et des contraintes associées (points nodaux, points de prélèvements et modalités de gestion des ouvrages) à l’échelle de ces sous bassins est apparue comme un enjeu afin de gérer au mieux d’éventuelles nouvelles crises et d’être en capacité de mieux partager et expliquer les décisions à prendre.
En réponse à ce besoin, la DREAL Occitanie, avec l’appui des DDT(M) du bassin et en collaboration avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la DRAAF Occitanie, a développé le premier prototype d’une application dénommée AVERSE (Appui à la Veille sur les Réserves et le Suivi de l’Etiage).
Cette version permet de disposer par sous-bassins :
- du suivi de la situation hydrologique sur les cours d’eau réalimentés ;
- de l’état des principales réserves de soutien d’étiage ;
- des liens de réalimentation entre retenues de soutien d’étiage et cours d’eau réalimentés (représentation par des segments bleus).
Plusieurs indicateurs utiles sur l’état des réserves disponibles pour le soutien d’étiage sont également calculés par sous-bassin (à 5 et à 13 jours).
Une vidéo de présentation complète cette actualité.
Pour en savoir plus : https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/averse-un-nouvel-outil-d-appui-a-la-veille-sur-les-a26500.html
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydromorphologie, Cours d’eau -
08/08/2023
- www.oieau.fr

Dans la continuité de la seconde quinzaine de mai, le soleil a brillé très généreusement sur la moitié nord du pays tandis que des épisodes pluvio-orageux localement violents se sont succédé sur les régions du Sud. Du 18 au 22, les orages ont toutefois concerné une grande partie du pays. Ils ont été accompagnés par endroits de pluies torrentielles et de fortes chutes de grêle et ont provoqué des inondations, notamment les 20 et 21 dans le Sud-Ouest.Les précipitations ont été excédentaires sur une grande partie du pays. Les cumuls ont atteint une à deux fois et demie la normale sur la moitié sud du pays ainsi que du sud du Centre-Val de Loire au sud de la Marne et plus localement du Poitou à l’est des Pays de la Loire et au sud de la Normandie. Sur l’Occitanie, la région PACA et la Corse, ils ont atteint deux fois et demie à trois fois et demie la normale. En revanche, ils ont été souvent déficitaires de 10 à 70 % des Hauts-de-France à la Touraine, de l’ouest de la Normandie à la Bretagne et à l’ouest de la Vendée, des Ardennes à l’Alsace et au nord-est de la Bourgogne, sur le Jura et le nord des Alpes ainsi que très localement sur le pourtour du golfe du Lion, la région niçoise et le littoral corse. Le déficit a dépassé 80 % sur l’est de la Lorraine. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de près de 10 %.Les sols superficiels se sont asséchés sur la moitié nord du pays alors qu’ils se sont humidifiés sur la moitié sud. Ils restent toutefois très secs sur le pourtour du golfe du Lion et le littoral occidental de la Corse.Courant juin, la vidange est active et les niveaux sont majoritairement en baisse (75%). Les précipitations ont permis d’enregistrer des épisodes de recharge et d’améliorer l’état des nappes uniquement sur les secteurs arrosés du tiers sud du territoire. La situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays : 68% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles en juin (66% en mai 2023) avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.Concernant les cours d’eau, bien que la situation se soit améliorée sur les zones ayant pu bénéficier d’une pluviométrie favorable comme la Corse ou le quart Sud-Ouest, elle s’est dégradée sur le Grand Est ainsi qu’en Bretagne.Au 12 juillet, 16 départements ont mis en œuvre des mesures de crise et 70 départements sont concernés par restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison en 2022 sur cette même période, 68 départements avaient mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau et 15 départements étaient concernés en 2021.
Mots-clés:Gestion de l'eau et des milieux -
03/07/2023
- www.services.eaufrance.fr

L’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement de l’OFB publie chaque année un rapport de portée nationale, intitulé “Panorama de l'organisation des services d'eau potable et d'assainissement et de leurs performances”.
Le nouveau rapport (Edition juin 2023) présente les résultats des indicateurs sur la tarification, la gestion financière, la qualité de l'eau potable, la gestion patrimoniale des services publics d'eau potable et d'assainissement de l'année 2021.
Il a été établi à partir des données renseignées par les collectivités dans la base Sispea (Système d'information des services publics d'eau et d'assainissement) au mois de Janvier 2023 de :
- 6 403 services d’eau potable (60 % des services du référentiel, 83 % de la population desservie)
- 6 554 services d’assainissement collectif (53 % des services du référentiel, 82 % de la population desservie)
- 1 246 services d’assainissement non collectif ont renseigné leurs données (50 % des services du référentiel, 79% de la population couverte)
Pour en savoir plus : https://www.services.eaufrance.fr/rapport-national
Pour accéder à Sispea : https://www.services.eaufrance.fr/
Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable et assainissement -
03/07/2023
- adour-garonne.eaufrance.fr

Le portail du système d’information du bassin Adour-Garonne a été mis à jour avec la première partie des données 2022 disponibles.
Ainsi, les analyses pour la campagne 2022 sont validées et permettent le calcul des états "écologie", et "chimie" à l'échelle des stations. L'état écologique sera, quant à lui, ajusté en septembre avec l'arrivée des données "poisson".
Ces indicateurs sont présentés au travers des fiches "station" (ex : https://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05148000) accessibles depuis la recherche https://adour-garonne.eaufrance.fr/recherche, par accès thématique ou accès cartographique.
Les archives "bassin" sont diffusées sur le catalogue de données :
- Les données brutes : https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/1dee5bac-215e-4ea5-9e34-66e...
- Les données d'état qui en découlent : https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/4d1ea178-3bf5-41bc-b510-fe9...
Pour explorer le portail : https://adour-garonne.eaufrance.fr/content/view/285/lang,fr/
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux
