Données sur l'eau
L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.
-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"
-
09/07/2024
- centrederessources-loirenature.com

Découvrez la nouvelle Méthode d'établissement de la Liste d'alerte des espèces exotiques potentiellement envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne !
Mots-clés:Donnée et système d'information, Faune, Poisson, Gestion de l'eau et des milieux, Pression, Espèce envahissante -
04/07/2024
- pole-lagunes.org

Dans le Cadre du Plan d’Action Régional Crabe bleu, le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie a mis en service depuis deux ans un outil de collecte de la donnée d’observation du Crabe bleu via un formulaire d’enquête en ligne ou sur application smartphone (ODK Collect). Les données ainsi recueillies permettent de standardiser les informations de localisation et de description des crabes bleus quel que soit l’usager ayant fait une observation ou une capture en Méditerranée.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Faune, Pression, Espèce envahissante, RDI -
04/07/2024
- sage-loire-rhone-alpes.fr
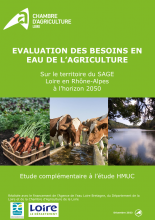
Afin d’enrichir le volet « U » de l’étude HMUC et mobiliser les expertises du territoire, la Commission Locale de l’eau a sollicité la Chambre d’agriculture de la Loire pour réaliser une étude sur les usages agricoles de l’eau, aujourd’hui et à l’horizon 2050.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Agriculture -
03/07/2024
- www.eaudeparis.fr

Où se désaltérer auprès d’une fontaine 2-en-1 ? Quelle est la Wallace la plus près de moi ? Quels établissements du quartier acceptent de remplir ma gourde d’eau ? Localisez facilement tous les points d'eau sur notre carte interactive sur fontaine.eaudeparis.fr.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable, Habitation et ville -
02/07/2024
- archimer.ifremer.fr
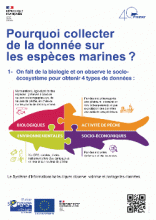
A l'occasion des 40 ans de l'Ifremer, des centres ont ouvert leurs portes au grand public. Le Système d'informations halieutiques (SIH) fut alors présenté, au travers des nombreuses actions menées, par les différentes équipes contribuant à ce réseau. Ce poster raconte aux visiteurs de tous âges pourquoi collecter de la donnée sur les espèces marines. Il illustre ainsi le besoin de faire de la biologie et d'observer le socio-écosystème, pour répondre ensuite aux besoins d'expertises sur les populations (en Atlantique pour cette version) et répondre aux questions de recherche actuelles.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Faune, Mer et océan -
02/07/2024
- inpn.mnhn.fr

L’Observatoire des Tortues Marines (OTM) est un programme scientifique piloté par le Muséum national d’Histoire naturelle, qui collecte toute observation sur les tortues marines fréquentant le littoral de France métropolitaine et de Saint Pierre et Miquelon, pour mieux les connaître et les protéger. L’OTM est structuré pour fournir les informations utiles aux politiques environnementales. Il est ainsi possible de surveiller l’évolution de l’état de conservation des tortues marines sur le territoire, et d’adapter les mesures à prendre pour les préserver.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Faune, Préservation, Littoral, Mer et océan -
02/07/2024
- www.eau-artois-picardie.fr

Chaque année l’ARS Hauts-de-France et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie publient un classement des eaux de baignade dans le bassin Artois-Picardie. Le classement 2024 montre la bonne qualité globale des eaux de baignade dans le bassin. Pour ce classement 2024, 10 sites de baignade sont classés excellents, 19 baignades sont classées en bonne qualité, 13 disposent d’une qualité d’eau suffisante et un est classé insuffisant. Le site du Crotoy reste interdit à la baignade.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Mer et océan, Opinion et société, Qualité de la ressource, Loisir, Baignade -
02/07/2024
- www.gesteau.fr

"Eau des Territoires" * est un outil national porté par la Banque des Territoires, qui agrège et fournit aux acteurs territoriaux concernés (direction eau et assainissement, EPTB, élus), en un même endroit, des indicateurs clés sur l’état de leurs ressources en eau (qualitatif, quantitatif, risques inondations et sécheresse, évaluation de la ressource dans le temps). Son objectif est de faciliter l’appropriation des enjeux et données sur l’eau et mieux intégrer le sujet de l’eau dans les prises de décision.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Gouvernance -
01/07/2024
- www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Au premier trimestre 2024, le trafic de marchandises transitant par les grands ports de commerce métropolitains stagne (- 0,2 %) par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 71,5 millions de tonnes (Mt), en données corrigées des variations saisonnières.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Mer et océan, Pêche et aquaculture -
28/06/2024
- www.federation-peche-allier.fr

L’application GEOPECHE, la carte halieutique interactive, est désormais totalement opérationnelle pour le département de l’Allier !
Pour accéder à l’interface : https://www.geopeche.com/
Pour accéder à la carte interactive du département de l’Allier : https://map.geopeche.com/03
Cette application permet aux pêcheurs de visualiser, avec la possibilité de se géolocaliser, tous les parcours de pêche et les aménagements des AAPPMA et de la Fédération de Pêche pour le département de l’Allier.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Gestion de l'eau et des milieux, Loisir -
28/06/2024
- www.services.eaufrance.fr

L’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement de l’OFB publie chaque année un rapport de portée nationale, intitulé “Panorama de l'organisation des services d'eau potable et d'assainissement et de leurs performances”.
Le nouveau rapport est déjà disponible ici et l'infographie également !
Il présente les résultats des indicateurs sur la tarification, la gestion financière, la qualité de l'eau potable, la gestion patrimoniale des services publics d'eau potable et d'assainissement de l'année 2022.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable et assainissement -
24/06/2024
- tourduvalat.org

Dans le cadre de nos travaux sur l’exposition des oiseaux marins aux plastiques, un nouvel article dédié à l’analyse du contenu des pelotes de réjection de goélands leucophées vient d’être publié dans la revue Marine Pollution Bulletin.
Mots-clés:Faune, Littoral, Pression, Déchet, Plastique -
24/06/2024
- www.oieau.fr
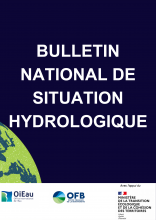
Le mois de mai a été marqué par une pluviométrie nettement excédentaire sur la quasi-totalité du pays avec de fréquents passages pluvieux. On a enregistré généralement 10 à 20 jours de pluie sur la majeure partie du pays, jusqu’à 22 jours soit 11 jours de plus que la normale à Gourdon (Lot) et Nevers (Nièvre) constituant des records mensuels. Des passages pluvio-orageux parfois virulents se sont produits du 1er au 5, notamment sur la moitié nord du pays puis du 12 au 24 et particulièrement sur le sud de la Normandie le 12 ainsi que sur le Bas-Rhin et la Moselle les 16 et 17. Ils se sont accompagnés d’inondations, de coulées de boue ou de glissements de terrain. Des chutes de neige se sont produites à haute altitude sur les Pyrénées et surtout les Alpes.
Les cumuls de pluie ont été généralement excédentaires de plus de 50 % sur la quasi-totalité du pays. L’excédent a souvent atteint une fois et demie à deux fois et demie la normale, jusqu’à trois fois sur le nord de la Moselle et du Bas-Rhin. En revanche, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 30 % de la plaine du Roussillon au littoral de l’Aude, sur le sud de la Provence et de la Corse ainsi que sur les Côtes-d’Armor. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de 60 %.
En ce qui concerne l’état des sols superficiels, la situation reste très contrastée entre la quasi-totalité de l’Hexagone avec des sols modérément humides à extrêmement humides et les régions méditerranéennes où ils sont très secs à extrêmement secs sur le sud du Languedoc-Roussillon et l’est de la Haute-Corse. Des records hauts d’indice d’humidité des sols superficiels ont été atteints dans le Poitou-Charentes, en Aquitaine et sur le Limousin.
Alors que la période de vidange semblait s’initier en avril, de nombreuses nappes ont bénéficié d’épisodes tardifs de recharge en mai. Les tendances sont restées hétérogènes, selon la réactivité de la nappe et les apports pluviométriques locaux.
Du fait d’une recharge 2023-2024 très excédentaire et perdurant jusqu’en mai, l’état des nappes est très satisfaisant sur une grande partie du territoire. Les niveaux sont généralement au-dessus des normales mensuelles. Seules des nappes très inertielles (Beauce, Sundgau, Bresse et Dombes) ou des secteurs présentant une recharge déficitaire (Roussillon, Aude et Corse) enregistrent des niveaux défavorables.
Sur l’ensemble du territoire, les débits des cours d’eau ont sensiblement augmenté en mai à l’exception du pourtour méditerranéen et de la Bretagne.
Au 10 juin, 6 départements sont concernés par des restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance dont 3 départements ont mis en œuvre des mesures de crise. À titre de comparaison en 2023 sur cette même période, 36 départements avaient mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau et 35 départements étaient concernés en 2022.Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Quantité de la ressource -
24/06/2024
- www.oieau.fr
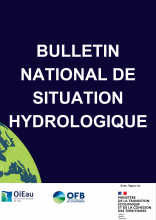
Précipitations
Avec 863 mm en moyenne sur la France, l'année hydrologique 2022 - 2023 présente un déficit de précipitations d'un peu moins de 10 %, déficit atteignant 30 % sur le territoire du Languedoc-Roussillon. Cette année hydrologique a été contrastée tant spatialement que temporellement. L'automne 2022 a été marqué par un déficit de précipitations prolongé sur la moitié Sud combiné à des épisodes de chaleur tardifs remarquables. L'hiver météorologique, déficitaire de 25% sur l'ensemble de la France a été suivi d'un printemps conforme aux normales avec toutefois un léger excédent sur la moitié nord mais un important déficit près de la Méditerranée malgré une fin de printemps assez arrosée. L'été a lui aussi été conforme aux normales.
Humidité des sols
Durant cette année hydrologique, les sols ont subi une alternance de périodes d’assèchement et d’humidification opposées sur les moitiés nord et sud du pays. En moyenne, à l’échelle de la France, l’humidité des sols est restée nettement inférieure à la normale de septembre 2022 à mars 2023 avant de redevenir proche de la normale malgré de forts contrastes spatiaux. En moyenne sur l'année, les territoires allant de l'Occitanie à la Bourgogne-Franche-Comté ont été marqués par un état des sols particulièrement sec que l'on observe habituellement tous les 10 à 25 ans.
Nappes
La situation du niveau des nappes en début d’année hydrologique est plus favorable qu’en 2022 à la même période (bien que toujours préoccupante), et plus contrastée géographiquement. En mai, 68% des niveaux des nappes étaient sous les normales mensuelles.
Etiages estivaux : assecs et ruptures d’écoulement
Les premiers assecs et ruptures d’écoulement sont observés, dès fin mai et s’amplifient jusqu’à fin août représentant plus d’un tiers d’observations de ce mois. Environ 15 % des observations réalisées entre fin mai et fin septembre 2023 rendent compte d’un assec (contre 21 % en 2022). L’Oise est le département pour lequel la part d’assecs est la plus importante en 2023 avec plus de 40 % du total des observations réalisées entre fin mai et fin septembre.
Taux de remplissage
Les barrages ont commencé l’année hydrologique avec des taux de remplissage à la baisse relativement conformes aux objectifs de gestion. A l’approche de l’été, les niveaux de remplissage des barrages étaient supérieurs à la normale suite à des épisodes de pluie qui ont engendré des épisodes de recharge, en particulier dans la partie nord du pays.Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Quantité de la ressource -
05/06/2024
- inpn.mnhn.fr

Chaque année, l’appel à projets pour l’amélioration des connaissances naturalistes mené dans le cadre de l’INPN et du SINP permet de financer l’acquisition de données sur les taxons et les écosystèmes méconnus et étudiés par des associations naturalistes. Les projets retenus contribuent ainsi à l’amélioration et au partage des connaissances via le SINP.
Récemment, les données collectées par 4 lauréats travaillant sur les milieux marins ont été intégrées et sont maintenant disponibles sur l’INPN et OpenObs. Il s’agit d’observations :
• De macroalgues en Martinique collectées par l’Association Aventures & Canyon ;
• De la faune de la zone mésophotique de Mayotte collectées par le Service de Plongée Scientifique ;
• De la faune et flore du littoral normand issues de la photothèque de la Cellule de Suivi du Littoral Normand ;
• De syngnathes de l’hexagone collectées par l’Association Peau-Bleue.L’ensemble de ces contributions permet d’apporter 1 240 observations sur 425 espèces marines d’outre-mer et de l’hexagone.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce -
05/06/2024
- archimer.ifremer.fr
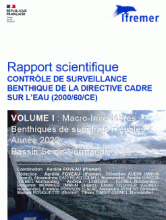
Ce rapport présente les résultats des opérations menées lors de l’année 2022 (contrôle de surveillance des invertébrés benthiques) sur l’ensemble des masses d’eau côtières, de transition et des sites d’appui rattachées au bassin Seine-Normandie.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Littoral, Mer et océan -
05/06/2024
- www.ofb.gouv.fr

Une équipe de chercheurs de plusieurs établissements, dont l'Office français de la biodiversité (OFB), a développé une nouvelle approche de modélisation pour mieux connaître la répartition en mer des poissons migrateurs amphihalins. La méthode appliquée à ces espèces menacées, comme les aloses ou l’anguille européenne, a permis des avancées importantes pour leur gestion en mer.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Mer et océan -
05/06/2024
- archimer.ifremer.fr
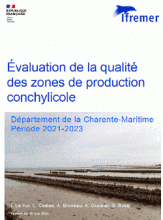
Après un rappel des objectifs, du fonctionnement et de la méthode d’interprétation des résultats du réseau de surveillance microbiologique REMI et du réseau de surveillance chimique ROCCH, ce rapport décrit le programme annuel du département de la Charente-Maritime. Il présente l’ensemble des résultats obtenus sur la période 2021-2023, en particulier l’estimation de la qualité microbiologique et chimique des zones de production de coquillages classées.
En 2023, un total de 34 zones de production a été suivi dans le département de la Charente-Maritime. 28 zones ont été suivies pour les coquillages du groupe 3 et 8 zones ont été suivies pour les coquillages du groupe 2. Le suivi REMI a été opéré à travers 40 lieux de surveillance. Le programme de surveillance microbiologique programmé en 2023 a été réalisé à 97.4%.
Au cours de l’année 2023, 19 alertes de niveau 1 ont été déclenchées. Ces alertes ont conduit à la réalisation de 20 prélèvements et analyses supplémentaires. En 2023, aucune alerte préventive de niveau 0 ou de niveau 2 n’a été déclenchée.
Sur la période 2021-2023, pour les coquillages du groupe 3, sept zones présentent une estimation de la qualité non concordante avec le classement en vigueur : une zone classée alternativement A/B (zone 17.03 Sud du Pertuis Breton) dont la qualité est estimée A sur l’ensemble de l’année ; une zone classée A dont la qualité est estimée B (17.11.01 Côte nord est Oléron) ; quatre zones classées A dont la qualité estimée est B liée à un seul résultat dépassant le seuil de 700 E. coli/ 100 g de CLI (17.02.02 Est du Pertuis Breton ostréicole ; 17.04.02 La Moulinatte ; 17.05.02 Sainte-Marie ; 17.09.04 Fouras) ; enfin la zone 17.09.05 Ile d’Aix classée A/B (alternatif) présente une qualité estimée B liée à un seul résultat dépassant le seuil de 700 E. coli/ 100 g de CLI pendant la période classée A du 1er mai au 31 octobre.
Les huit zones suivies pour les coquillages du groupe 2 ont une qualité estimée B concordante avec le classement en vigueur.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Faune, Littoral, Mer et océan, Qualité de la ressource -
05/06/2024
- www.ifremer.fr

L'Ifremer et le CNRS ont été mandatés par les ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et de la mer, pour conduire une expertise scientifique collective (ESCo) portant sur les effets des parcs éoliens en mer et de leurs raccordements sur la biodiversité marine et les socio-écosystèmes marins et côtiers.
Mots-clés:Donnée et système d'information, Mer et océan -
05/06/2024
- archimer.ifremer.fr
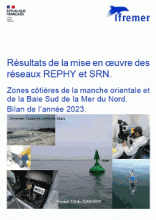
Le littoral Nord - Pas-de-Calais / Picardie montre de nombreux signes de dysfonctionnements induits principalement par l’activité anthropique. Ces signes se manifestent presque toujours par un déséquilibre des populations, qu’elles soient animales ou végétales. En effet, certaines espèces dominent. C’est le cas de la Prymnesiophycée Phaeocystis sp., une algue phytoplanctonique naturelle qui prolifère tous les ans au printemps. Le cycle de développement de l’espèce évolue depuis quelques années (modification de l’amplitude, de la durée et de l’extension graphique du bloom) et est fortement lié à la dynamique des sels nutritifs comme les nitrates et les phosphates par exemple.
Dans le cadre de l’évaluation de l’influence des apports continentaux en éléments nutritifs sur d’éventuels processus d’eutrophisation du milieu marin, de l’estimation de l’efficacité des stations d’épuration à éliminer de telles substances et afin d’établir un suivi à long terme permettant de suivre l’évolution de la qualité des eaux littorales, le réseau de Suivi Régional des Nutriments (SRN) a été mis en place par l’Ifremer en collaboration avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie en 1992 afin de compléter le réseau REPHY (Réseau Phytoplancton et Phycotoxines).
Ce rapport présente les principaux résultats de l’année 2023 en termes d’évolution temporelle des paramètres physico-chimiques et biologiques caractéristiques des masses d’eaux échantillonnées au niveau des points de surveillance de trois radiales situées à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer et en Baie de Somme.Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Mer et océan, Qualité de la ressource
